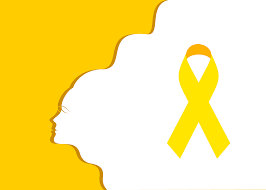Superviseur en travail social depuis 15 ans, j’ai écrit ce texte initialement en 2010 pour tenter de rendre compte, de ma place, d’un processus qui, pour partie, garde encore aujourd’hui sa part de mystère.
Le regard que je porte aujourd’hui sur mon intervention est bien différent de celui qui était le mien au début de ce qu’il faut bien appeler un métier à part entière. Il est d’emblée question du désir : le mien, celui de l’autre. Le mien était de transmettre, de faire partager l’expérience accumulée au contact des personnes dites marginales, handicapées, exclues, en errance, et des collègues avec qui il était si important de pouvoir collaborer, construire, échanger, penser ensemble une action porteuse de sens et en même temps soutenue par lui.
Durant presque toute ma carrière de travailleur social, j’ai bénéficié de supervisions, animées par des professionnels formés à la psychologie clinique, la psychanalyse et la PNL. Ce que j’en ai gardé : l’importance d’avoir un lieu pour penser mon action, pour m’en distancier et partager avec d’autres tout ce qui peut me traverser quand l’autre, personne qui souffre, met à l’épreuve ma capacité à contenir, à lui résister, à patienter, à attendre que pour lui arrive le moment d’un pouvoir être autrement, d’un pouvoir faire autrement.
Ce qui me passionne dans l’exercice de ce métier de superviseur c’est à la fois la grande variété des humains que je rencontre et la joyeuse complexité que je goûte de plus en plus, notamment dans la posture qu’il est question de trouver, d’occuper, de lâcher, de conquérir, d’abandonner …et de reprendre.
Entrer dans le groupe
La sensibilité systémique, qui m’accompagne depuis longtemps, m’a permis de sentir très vite qu’il était peut être illusoire de penser pouvoir entrer dans un système sans en faire partie d’emblée.
Ce qui pourrait passer pour une évidence au plan conceptuel l’est moins dès qu’il est question de s’immerger au sein d’un groupe, écosystème à part entière, qui ne m’a pas attendu pour fonctionner, qui n’attend peut être rien de moi, ou trop de moi, ou encore de faire comme si je n’étais pas un autre à part entière.
Quand j’entre dans un groupe, j’en fais donc aussitôt partie. Que ça me plaise ou non, je me retrouve à partager ce que vivent les professionnels : des questions (je me demande si…), des peurs (de quoi ?), des doutes (je ne sais plus), des hésitations, des fulgurances (Eurékâ !!), l’incompréhension (mais qu’est ce qu’ils racontent ?), la colère (comment font-ils pour supporter tout ça ?), l’impossible, l’impuissance, la résignation (à quoi bon ?), le découragement (ça n’avance pas), la confusion (je n’y comprends plus rien).
La position « méta »
J’apprends à me laisser traverser par les ressentis, les émotions des personnes qui constituent ces groupes en utilisant ce que l’on appelle communément la position ‘’méta’’ qui permet d’être là tout en s’observant. Cette position particulière ne m’empêche pas de ressentir toute la palette émotionnelle décrite plus haut, mais m’aide à occuper une posture qui m’est singulière, et qui me permet de ne pas être absorbé ni englouti par les débordements de toutes sortes auxquels je suis confronté.
Ce qui me vient c’est ce titre d’un film de Wenders ’’Si loin, si proche’’ : il s’agirait de prendre le risque d’être proche d’eux, ces professionnels, au risque de me perdre en cours de route, et de ne plus me distinguer d’eux, voire de souffrir comme eux ; et en même temps de m’extraire de la situation, de m’en éloigner, de me décentrer pour ‘’recouvrer mes esprits’’, au risque de me retrouver trop loin d’eux, de leurs préoccupations, de ce qui les agite, les anime autant.
Je passe par une phase d’immersion, où pour un temps donné je ne me distingue pas complètement des personnes présentes : pour partie, je suis comme eux. Ou je fais comme si j’étais comme eux, mais sans que cela soit forcément conscient et volontaire.
En même temps je suis porté par cette conviction que ‘’je ne suis pas eux’’ : nous partageons l’appartenance au genre humain, le fait d’être travailleur social de formation (ou d’état d’esprit, ou d’état d’être) mais je n’ai ni la même place, ni la même position, ni la même posture qu’eux. Je l’assume et je le revendique. Je peux conjuguer l’idée de parité et de singularité au sein d’un même groupe.
Produire du mouvement, sortir de la plainte
C’est l’affirmation de cette singularité qui me permet de ne pas être complètement englouti, absorbé par un groupe au risque de voir niée ma différence. Or c’est bien cette différence qui peut produire du mouvement.
Ce mouvement passe par une modification de la position du professionnel, qui lui demande d’apprendre à se situer autrement. Je crois aux vertus de la contagion dans tout processus de relation humaine. Je fais le choix de me focaliser sur la contagion positive, utile, productive voire opérationnelle.
A force de patience (et il en faut !), d’écoute active et bienveillante, de reformulation, de recadrage, je leur donne la possibilité de sortir de ce que j’appelle ‘’la plainte’’. La plainte c’est cette expression incontournable du processus, temps pendant lequel les professionnels ont besoin de croire, d’exprimer que l’origine de leur mal être, de leur souffrance au travail a des causes extérieures à eux. Ces causes vont des cadres hiérarchiques aux usagers en passant par les collègues ou l’état des locaux. Jusqu’au moment où l’un d’entre eux pose la question : et moi là dedans ? En quoi suis je acteur, auteur de ce que je vis, de ce qui se passe ici pour moi ?
Ce mouvement attendu n’est possible que si je ne cherche pas à faire entrer les professionnels de ces groupes de supervision dans un quelconque modèle théorique, que je sache m’adapter à leur situation présente et inventer à chaque fois de quoi leur permettre d’avancer, m’inspirant en cela de la façon dont François Roustang parle aujourd’hui de sa vision de l’accompagnement en hypnothérapie. Tout cela est très séduisant sur le plan intellectuel, il en va autrement sur le terrain.
Les contraintes du terrain
Ils appartiennent tous à des organisations aux prises avec les contraintes actuelles, où il est d’abord question de réduction des coûts, de contrôle des dépenses, de précarités d’emploi et de fonction, de traçabilité, de démarche qualité. La systématisation des procédures d’évaluation a banalisé les emprunts sémantiques au monde de l’entreprise, au risque d’oublier que nous sommes avant tout des sujets et non des objets.
Ce lancinant leitmotiv, où la valeur première serait l’argent, ajouté à la question hautement sensible du pouvoir, sujet tabou s’il en est, fait du mal à tout le monde : aux décideurs et aux tutelles, qui en oublient parfois leurs premières raisons d’être (du genre financer une action sociale de qualité –humaine-) ; aux responsables des institutions qui subissent à leur tour cette pression extrême de recherche d’économie à tout prix, au risque d’oublier les valeurs qui guident l’intervention sociale ; aux professionnels, pris de plus en plus dans une double contrainte qui rend fou (faites en plus et mieux avec moins de moyens) ; aux publics qui subissent de plein fouet ce qu’ils reconnaissent d’emblée : la sensation douloureuse d’être à nouveau laissés à l’abandon.
Semer les graines d’un « penser autrement »
Malgré l’expérience que j’ai de ce type d’intervention, il m’arrive souvent de me demander à quoi je travaille vraiment, au service de qui et de quoi je suis. Pour autant il n’est pas question pour moi de me résigner.
Occuper cette place de superviseur devient de plus en plus un choix militant, où les valeurs qui me guident restent là, valeurs avec lesquelles il n’est pas question que je transige. L’air de rien, je continue à penser qu’un superviseur peut toujours mettre au service de l’autre ce qu’il voit.
Superviser c’est voir au-delà, au-delà des apparences, au-delà des évidences, au-delà des mirages et des illusions. C’est voir plus loin que l’ici et maintenant, c’est déjouer les pièges d’une pensée unique, figée, sclérosée, frileuse et potentiellement déshumanisante.
Humain je suis, humain je reste.
Sujet je suis, sujet je reste.
Soutenir cette posture vaille que vaille, coûte que coûte, c’est semer les graines d’un penser autrement, d’un ‘’se penser autrement’’, avec comme vision ‘’un pouvoir faire autrement.
Bruno DEGRELLE, superviseur du Travail Social, mai 2010